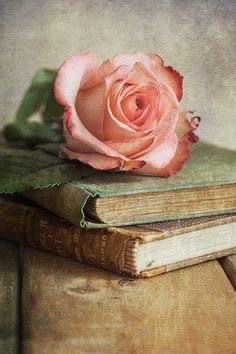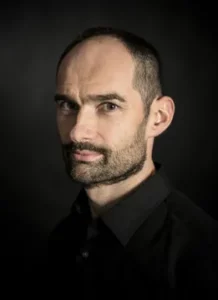
Laisser-parler ou comment les États-Unis tentent de détruire la démocratie
Par Arnaud Esquerre
SOCIOLOGUE
Il y a quelques jours, JD Vance, le vice-président des États-Unis, alertait l’Europe : elle verserait, selon lui, dans l’autoritarisme en oubliant la liberté d’expression. Mais ce qu’il appelle démocratie, c’est cette liberté d’expression où est entendu celui qui crie le plus fort les propos les plus obscènes, c’est cet espace public aux mains des milliardaires. Et n’est pas la définition européenne, à savoir une liberté en commun et respectueuse de tous.
Il y aurait, pour l’avenir de l’Europe, plus dangereux que la Russie, que la Chine, que n’importe quel autre acteur extérieur : le plus inquiétant serait, d’après le vice-président des États-Unis, James David Vance, une « menace venant de l’intérieur ». Pour qui habite en Europe, l’annonce d’une telle menace décelée par l’administration disposant des moyens d’espionnage les plus puissants au monde peut paraître des plus angoissantes. Les gouvernements européens seraient-ils manipulés par une force occulte ? Des extraterrestres nous contrôleraient-ils sans que nous nous en rendions compte ?
Nullement. Cette menace qui vient de l’intérieur, nous a révélé James D. Vance dans un discours prononcé à Munich, le 14 février 2025, ce serait le « recul » de la liberté d’expression[1]. Les États européens démocratiques ne seraient, en fait, plus démocratiques car ils auraient perdu la liberté d’expression sans s’en apercevoir. Ils seraient devenus, même, les héritiers de l’URSS. Les États communistes de la Guerre froide et les États européens d’aujourd’hui auraient en commun, si l’on écoute James D. Vance, de censurer les dissidents, de fermer les églises et d’annuler les élections.
Il est vrai, reconnaît James D. Vance, que les États-Unis eux-mêmes sortiraient à peine d’un tel effacement démocratique : l’administration Biden « a semblé prête à tout pour faire taire ceux qui exprimaient librement leurs opinions ». Heureusement, un « nouveau shérif » est arrivé à Washington, Donald Trump, flanqué d’Elon Musk : même s’ils seront en désaccord avec nos opinions, ils se battront, assure Vance, pour défendre notre droit à les exprimer sur la place publique.
Mon opinion depuis l’Europe, cette opinion pour laquelle Donald Trump, Elon Musk et James D. Vance disent être prêts à se battre, est cependant que la liberté d’expression n’y est pas en retrait. Elle n’y a même jamais été aussi étendue. En France, on n’a jamais pu autant s’exprimer depuis la fin de la censure par l’État et par l’Église, qui s’appliquait encore au cinéma jusque dans les années 1970, depuis la fin de l’ORTF et depuis la multiplication des médias audiovisuels, puis des espaces de discussion sur internet, sur des réseaux sociaux, mais aussi sur des sites permettant de commenter l’actualité comme il en existe sur des sites de médias. On n’a jamais pu prononcer, entendre et lire autant de critiques, en de multiples espaces publics, ces critiques qui font la vitalité de la démocratie, à tel point que certains, en général les voix qui se pensent les plus autorisées, se plaignent qu’il y a trop de critiques ou que ces critiques ne prennent pas des formes suffisamment nobles.
Le discours selon lequel nous vivrions dans une fausse démocratie parce qu’« on ne peut plus rien dire » n’est pas neuf : on l’entend depuis les années 1990 dénoncer, d’abord, le « politiquement correct », puis, dans les années les plus récentes, le « wokisme » et la « cancel culture ». Ce qui est inédit, c’est qu’il n’est plus exprimé seulement par quelques universitaires, essayistes, hommes de lettres et autres commentateurs nostalgiques d’une époque où l’on n’avait pas à faire attention à ne pas exprimer des propos misogynes, racistes, homophobes, transphobes ou climatosceptiques ; ce qui est inédit, c’est qu’il est devenu le discours officiel du gouvernement des États-Unis. Désormais, son vice-président s’alarme de ce que des citoyens allemands ne puissent pas publier en ligne des « commentaires antiféministes » en toute tranquillité.
Il faut donc constater une divergence dans la manière de comprendre ce qu’est la démocratie. Ce que Vance propose d’appeler démocratie n’est pas ce que nous appelons démocratie. Il n’y a pas lieu de s’en étonner grandement car ce qu’on entend par démocratie est fort divers et n’a pas cessé de se modifier dans le temps. La question est de savoir à quelle conception de la démocratie nous tenons en Europe et pourquoi elle n’est pas la même que la Vance-democracy.
Il faut, pour cela, examiner de plus près les exemples avancés par le vice-président des États-Unis. Tout d’abord, le héros de la Vance-democracy n’est pas issu des révolutions américaine ou française, non, il s’agit d’un pape, c’est-à-dire le chef d’un État, le Vatican, qu’il est difficile de considérer comme une démocratie, même en tordant le sens de ce mot autant que possible. Ce pape est Jean-Paul II, présenté par Vance comme « l’un des plus extraordinaires champions de la démocratie sur ce continent ou d’ailleurs ».
La phrase que Vance, converti au catholicisme en 2019, reprend à Jean-Paul II comme fondement de la Vance-democracyest : « N’ayez pas peur ! » Jean-Paul II l’a prononcée le 22 octobre 1978 lors de la messe solennelle de son intronisation : « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait “ce qu’il y a dans l’homme” ! Et lui seul le sait ! » C’est, dans l’Évangile selon Marc, Jésus qui dit : « N’ayez pas peur ! » à ses disciples parce que ces derniers le voient marcher sur la mer.
Voici, donc, la référence au cœur de la Vance-democracy. Il ne faut pas craindre le « peuple », qui occupe la place de Jésus, nous proclame le vice-président des États-Unis, qui s’est mis, lui, à la place du pape, les dirigeants européens étant les disciples poussant des cris.
On comprend mieux, alors, le choix d’une partie des exemples censés témoigner d’un recul de la liberté d’expression en Europe. Ce sont des cas de « militants chrétiens », selon l’expression de Vance, condamnés l’un en Suède pour avoir brûlé des exemplaires du Coran avec un compagnon qui, lui, a été tué par balles le 30 janvier 2025, l’autre au Royaume-Uni pour avoir prié à proximité d’une clinique où se pratiquent des IVG.
Ces exemples détournent l’attention du fait que, ces dernières décennies, des « militants chrétiens » ont, par des actions légales et d’autres illégales, tenté de faire reculer la liberté d’expression, au nom de l’offense aux sentiments religieux ou de la protection de la jeunesse, en contestant le visa délivré à tel film, en empêchant telle pièce de théâtre, en détruisant telle œuvre d’art. Jean-Paul II, ce champion de la Vance-democracy, avait lui-même condamné, en 1985, la distribution à Rome du film de Jean-Luc Godard Je vous salue Marie qui, expliquait-il, « blesse profondément les sentiments religieux des croyants ».
Les autres exemples pris par Vance visent ce qui circule sur les réseaux sociaux. D’après lui, il ne devrait pas y avoir de « pare-feu » quel que soit ce que dit le « peuple » sur un réseau social, pas de limitation aux « discours de haine », ni d’actions en justice lorsque des messages diffusés en masse sur des réseaux sociaux à l’initiative d’un État étranger modifient, ou visent à modifier, le résultat d’un vote. James D. Vance regrette ainsi qu’en Roumanie, la Cour constitutionnelle ait annulé, le 6 décembre 2024, le premier tour de l’élection présidentielle après avoir constaté que des messages avaient été massivement publiés sur TikTok en faveur d’un candidat partisan de la Russie et arrivé en tête du scrutin. En Vance-democracy, « désinformation » est un « mot hideux de l’ère soviétique » utilisé par quelqu’un ne supportant pas un point de vue, ou un vote, différent du sien.
Cependant, si les démocraties européennes ne sont pas des Vance-democracies, si elles limitent la liberté d’expression, c’est parce qu’il s’agit de préserver l’espace public où l’on s’exprime librement de son autodestruction. Car la liberté d’expression est toujours menacée par elle-même, c’est-à-dire par la violence qu’elle autorise.
Et si, dans une démocratie fondée sur la liberté d’expression comme le sont les États européens, des énoncés faux et des énoncés vrais doivent pouvoir, en effet, coexister, lorsque les citoyens sont appelés à voter, pour élire des représentants ou à l’occasion d’un référendum, et que, par cette action, ils choisissent dans quelle histoire politique ils veulent s’engager, la sauvegarde de cette démocratie ne peut se faire qu’en ayant connaissance de faits vrais. Pour que ces États soient encore plus démocratiques, l’espace public devrait être en commun, c’est-à-dire produit de telle sorte que nous pourrions nous exprimer véritablement de manière libre et égale, selon nos propres règles, et non pas capté par une poignée qui en retire, de manière directe ou indirecte, des profits financiers.
Car ce que ne dit pas le thuriféraire de la Vance-democracy, c’est qu’elle repose sur une privatisation de l’espace public par de grandes entreprises aux mains de très riches actionnaires. Vance fait comme si chacune et chacun avait la possibilité de s’exprimer librement de manière égale et comme si chaque voix avait la même portée dans la Vance-democracy. Or l’espace public y est privatisé de telle sorte que certaines opinions sont privilégiées par rapport à d’autres parce que ceux qui s’estiment propriétaires de l’espace public en ont décidé ainsi ou parce que ceux qui ont les moyens financiers de diffuser massivement telle opinion le font sans entrave.
La menace la plus inquiétante, aujourd’hui, pour la démocratie en Europe ne vient pas de l’intérieur, mais des États-Unis.